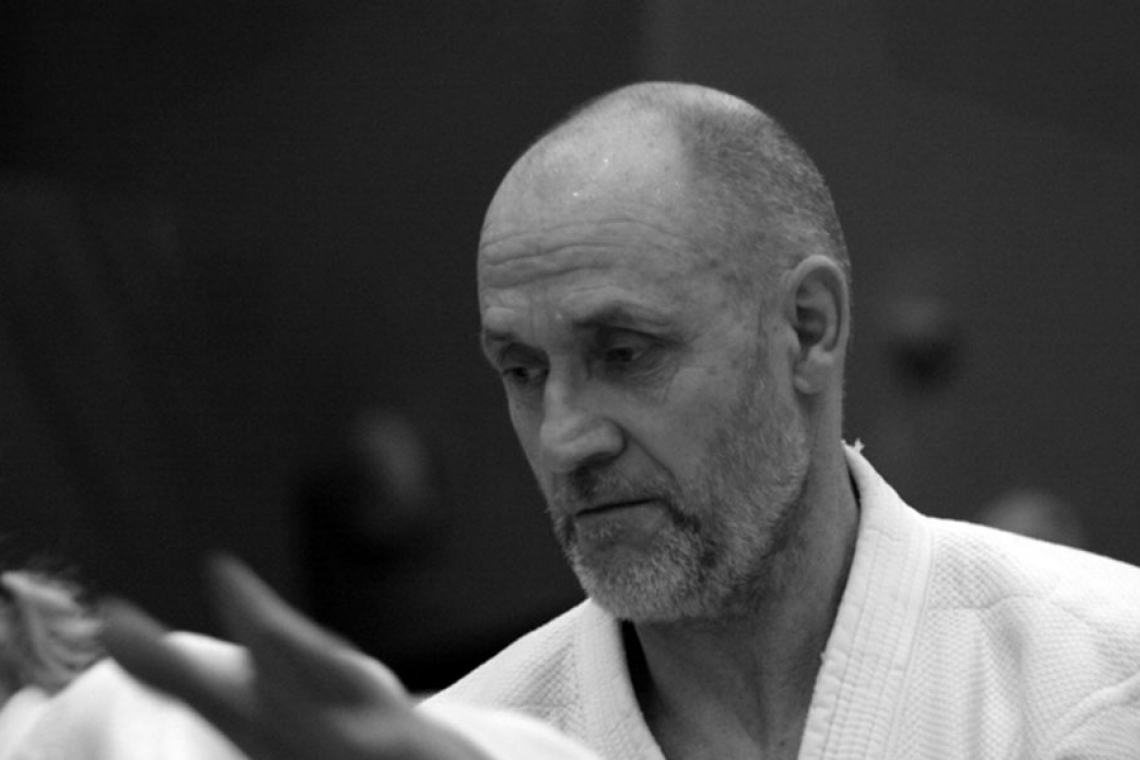Philippe Gouttard, 6°dan FFAAA, a découvert l'Aikido en 1970. Il s'est très vite investi dans la pratique et a voyagé énormément en France et à l'étranger afin de suivre l'enseignement d'experts japonais tels que Tamura Nobuyoshi, Noro Masamichi et Kobayashi Hirokazu. Au cours d'un stage de Maître Noro il a rencontré Maître Asaï Katsuaki et il s'est décidé à aller vivre en Allemagne afin de suivre l'enseignement de ce maître pendant 7 ans. Philippe Gouttard a rencontré Christian Tissier en 1978 et il suit son enseignement depuis ce jour. Philippe a aussi particulièrement été influencé par Maître Yamaguchi Seigo avec qui il a beaucoup pratiqué lors de ses nombreux séjours au Hombu Dojo de Tokyo. Il se rend d'ailleurs au Japon chaque année depuis plus de 30 ans. Philippe Gouttard enseigne principalement à Grenoble et Saint-Étienne et il a d'ailleurs assumé la fonction de responsable technique de la région Rhône-Alpes pour la FFAAA pendant 15 ans. Philippe donne aujourd'hui de nombreux stages en France ainsi qu'à l'étranger. Profitant de la venue du monsieur à Dublin, nous avons saisi l'occasion pour lui poser des questions sur les fondements de sa pratique.
J'ai découvert l'Aikido par hasard : je suis tombé un jour sur une publicité qui disait « devenez invincible en 11 leçons » alors je me suis dit bon, 11 leçons, on va essayer... Guillaume Erard : Comment as-tu commencé l'Aikido ?
Philippe Gouttard : J'ai commencé l'Aikido comme quelque chose de très physique. Pour moi c'était du sport, c'est-à-dire que je voulais être champion du monde.
Guillaume Erard : Car tu venais du sport...
Philippe Gouttard : Du foot, j'en faisais beaucoup, je voulais être professionnel. J'étais à l'AS Saint-Étienne à la grande époque, quand il y avait Larqué, Piazza, Rocheteau, tous ces gens-là. Moi je voulais être la génération d'après. Peut-être que je ne jouais pas assez bien pour y arriver, mais je m'entraînais comme un fou, cinq heures par jour, à mort. J'ai découvert l'Aikido par hasard : je suis tombé un jour sur une publicité qui disait « devenez invincible en 11 leçons » alors je me suis dit bon, 11 leçons, on va essayer... En fait, je me suis trompé d'adresse et je me suis retrouvé chez le professeur d'Aikido. Je lui ai dit « je viens pour les 11 leçons ». Ça l'a bien fait rire et il m'a dit « commence déjà par en faire une » ; je ne suis jamais parti. Par contre, je regrette toujours de ne pas être allé voir le mec des 11 leçons pour voir ce que c'était (rires). À l'époque, personne ne savait ce que c'était que l'Aikido. Je me suis d'ailleurs fait casser de partout, les poignets, les coudes, à cause de ça...

Philippe Gouttard et Guillaume Erard
Guillaume Erard : C'était de l'Aikido violent ? Je me souviens, quand les Japonais venaient en Europe, ils ne prenaient pas des aikidokas mais des judokas pour démontrer, parce que nous ne savions pas chuter alors que les judokas avaient appris à tomber.
Philippe Gouttard : Non, pas tellement. En fait, ce n'était surtout pas bien expliqué. On tordait le poignet et le uke chutait comme il pouvait, mais mal. Je me souviens, quand les Japonais venaient en Europe, ils ne prenaient pas des aikidokas mais des judokas pour démontrer, parce que nous ne savions pas chuter alors que les judokas avaient appris à tomber. Moi, la première chute avant correcte que j'ai faite, c'est deux ans après avoir commencé alors que maintenant, les gens font ça dès trois ou quatre mois. J'ai donc beaucoup souffert physiquement par méconnaissance des systèmes. Les Japonais n'expliquaient rien du tout et les professeurs non plus. Ils montraient et nous on ne comprenait rien. Je me suis donc rapidement dit que ce n'était pas normal qu'un sport aussi bien pensé soit aussi mal expliqué. J'ai donc suivi beaucoup de Japonais en Europe, sans comprendre, jusqu'au jour où j'ai rencontré Christian Tissier.
Guillaume Erard : Comment cette rencontre s'est-elle passée ?
Philippe Gouttard : C'est amusant parce que j'enseignais déjà à Saint-Étienne, mais en fait je n'enseignais rien du tout. Le professeur chez qui j'ai commencé a arrêté deux ans après pour faire du Kendo. On s'est donc retrouvés un peu orphelins. Beaucoup ont arrêté sauf quelques jeunes qui ont voulu continuer, mais qui ne savaient pas comment, ou qui allait enseigner. J'ai donc proposé de m'en occuper, mais comme je ne connaissais rien, je leur ai fait faire du sport. On faisait des pompes, des abdominaux, etc. Sur une heure d'Aikido on faisait cinq minutes de technique, mais on se construisait bien le corps. Dans le but de progresser quand même, je faisais beaucoup de stages. J'ai rencontré Maître Noro, que j'ai beaucoup aimé, ainsi que Maître Asai en Allemagne, mais il n'y avait toujours pas d'explication sur le physique. Un jour, Christian Tissier, qui était juste rentré du Japon, est venu à Saint-Étienne. En le voyant je me suis tout de suite dit « c'est ça qu'il faut faire ». Ce qui est amusant c'est que les autres membres du groupe n'ont pas aimé. C'est là que je me suis dit que le jugement était une question de moment. Si Christian Tissier était venu dix jours avant ou après, peut-être que j'aurais dit que c'était nul et les autres que c'était bien. J'étais donc dans le bon état pour recevoir cet enseignement et je me suis dit « c'est ça que je veux faire ». Je suis donc allé le voir et depuis, je ne l'ai plus jamais quitté.
Guillaume Erard : Qu'est-ce que Christian Tissier apporte à ta pratique ?
Philippe Gouttard : Énormément de choses. Pour moi, je ne peux pas dire que ce soit un « maître » parce que j'ai le même âge que lui, mais c'est vraiment quelqu'un qui me pousse à aller de l'avant dans la réflexion. Même si nous ne sommes pas amis intimes car on ne se voit guère que sur le tapis, c'est la personne envers qui j'ai le plus de respect. C'est simple : s'il n'avait pas été là, je ne serais pas là. Grâce à lui j'ai pu rencontrer des maîtres japonais, aller au Japon et surtout grâce à sa pratique, j'ai pu comprendre celle des instructeurs japonais.

Philippe Gouttard et Guillaume Erard
moi j'ai toujours eu envie d'aller voir tout le monde alors j'allais également voir tous les autres professeurs. Guillaume Erard : Quels autres enseignants allais-tu voir ?
Philippe Gouttard : Inévitablement, Christian allait voir les Japonais qu'il préférait tels que Maître Yamaguchi Seigo, Maître Osawa Kisaburo, le second Doshu, Maître Masuda Seijuro, donc je suivais ça tout naturellement. Par contre, moi j'ai toujours eu envie d'aller voir tout le monde alors j'allais également voir tous les autres professeurs. Il y a d'ailleurs beaucoup d'enseignants qui n'appartenaient pas à cette voie que nous travaillons en France mais qui m'ont bien plu ; peut-être plus d'un point de vue humain que technique, d'ailleurs. J'ai toujours trouvé l'Aikido un peu fermé alors que ces professeurs, qui étaient peut-être un petit peu moins « brillants », avaient eux plus tendance à aller boire un coup avec les gens ou même les inviter. Au début, ne parlant pas japonais, j'ai beaucoup apprécié ça.
Guillaume Erard : À présent que tu parles couramment le japonais, est-ce que cela a changé ta compréhension de l'Aikido que ces maîtres pratiquaient ? Un homme comme Maître Yamaguchi m'a beaucoup aidé, car il était un peu non conformiste et c'est ce que moi j'essaie de faire sur le tapis.
Philippe Gouttard : En fait, une fois que j'ai compris, j'ai été un peu déçu par le fait qu'ils parlaient exactement comme nous. Je croyais qu'ils allaient utiliser un langage poétique, fleuri, mais pas du tout. Ils parlaient comme nous : « levez le bras, descendez la jambe, vous êtes des minables... » (rires). Quand je suis arrivé au Japon, j'étais persuadé que les maîtres vivaient dans les arbres, qu'ils ne mangeaient pas, ne touchaient pas aux filles, etc. Quand j'ai vu que de temps en temps ils buvaient et étaient saouls j'ai été très déçu. J'ai réalisé que ces gens étaient des maîtres virtuoses en aikido, mais surtout qu'ils étaient aussi des hommes japonais qui vivaient selon les coutumes de leur pays.
Guillaume Erard : Y a-t-il un enseignant japonais qui ait eu sur toi une influence particulière ?
Philippe Gouttard : Un homme comme Maître Yamaguchi m'a beaucoup aidé, car il était un peu non conformiste et c'est ce que moi j'essaie de faire sur le tapis. Il n'était pas dans la norme Aikikai, car par exemple, fumer à l'Aikikai, c'était interdit, mais lui, il fumait. Il faisait les cours qu'il voulait, parfois même, il ne venait même pas (rires). Pour moi, il a poussé la liberté vers un paroxysme. C'est un homme que je ne trouvais pas beau, mais quand il était sur le tapis, je le trouvais magnifique. J'ai beaucoup appris à son contact. Au fur et à mesure que j'ai été au contact de ces gens et que j'ai passé des caps en Aikido, je me suis dit que finalement, mourir dans les bras d'un homme comme Christian Tissier ou bien Maître Yamaguchi, ça ne me dérangerait pas.

Philippe Gouttard et Guillaume Erard
Guillaume Erard : L'Aikido n'est pas ta seule passion, tu consacres beaucoup de temps à l'étude des langues et de l'ostéopathie...
Philippe Gouttard : C'est venu parce qu'il y avait toujours cette notion de ne pas comprendre comment le corps marche. Je me suis dit que si je n'arrivais pas à trouver ça dans l'Aikido, je devais essayer de le trouver ailleurs. J'ai donc commencé des études d'ostéopathie pour comprendre la mécanique humaine. Pour moi c'était impensable que des professeurs qui travaillent sur le corps ne sachent pas comment il est fait. Ça m'a permis de réaliser que le corps humain est le même partout, mais c'est l'expression de la douleur ou du plaisir qui n'est pas la même. En français, on dit « aïe » quand on a mal alors qu'au Japon ça veut dire « oui ». Forcément le pratiquant en face va se dire « mais qu'est-ce qu'il me dit, il veut encore ou pas ? » (rires). C'est donc pour cela que j'ai commencé à apprendre les langues, afin de comprendre comment les gens pensent. Je me dis que si, quand je vais enseigner à droite et à gauche, je suis incapable de parler la langue, je ne vois pas comment les élèves vont comprendre mon Aikido. Je ne voulais pas répéter les erreurs des professeurs de mes débuts. Par rapport à un traducteur qui traduirait très bien mot à mot, mais qui ne traduit pas forcément bien la pensée, je préfère une explication avec un langage plus approximatif, mais qui m'est personnel. Comme ça, les gens l'intègrent petit à petit au fur et à mesure que je vais les voir et au final, ils me comprennent bien. Une fois qu'ils comprennent bien ce que je dis, moi je comprends bien ce qu'ils font et on commence à faire de l'Aikido ensemble.
Guillaume Erard : Est-ce que tes connaissances en ostéopathie t'aident à enseigner l'Aikido ? Tout cela m'a permis de me demander : « au lieu de penser à faire mal, contrôler, tordre les poignets, est-ce que l'on ne pourrait pas dire, on va construire le corps ? » Alors au début on construit le sien, on est très fort, mais à quoi cela sert-il d'être fort si c'est pour détruire l'autre ?
Philippe Gouttard : J'ai fait des études d'ostéopathie parce que cette discipline envisage le corps dans son ensemble, à la différence de la médecine traditionnelle qui divise le corps en fonctions et en systèmes. C'est là que j'ai réalisé que par exemple, les mains et les pieds devaient travailler de manière identique car au départ, nous nous déplacions à quatre pattes. Ceci implique également que les genoux et les coudes doivent avoir la même fonction, ainsi que les épaules et les hanches, qui portent des membres, et doivent donc avoir les mêmes sensations. Le tout est régi par la tête qui nous place dans l'espace avec la vue, l'ouïe, etc. J'ai donc réfléchi à l'action des mains et des pieds. Les mains et les pieds sont les parties de notre corps qui nous permettent d'être en contact avec le tapis (les pieds) et le partenaire (les mains). On peut diviser la main en deux parties si on coupe celle-ci dans le sens longitudinal. Le petit doigt et l'annulaire forment ce que nous appellerons la main de la force et le majeur et l'index forment la main de la précision. Pour les pieds il y a la même analogie que pour les mains, je peux diviser le pied en deux : le pied de la réception, les trois derniers orteils, et le pied de la propulsion, les deux premiers. Tout cela m'a permis de me demander : « au lieu de penser à faire mal, contrôler, tordre les poignets, est-ce que l'on ne pourrait pas dire, on va construire le corps ? » Alors au début on construit le sien, on est très fort, mais à quoi cela sert-il d'être fort si c'est pour détruire l'autre ? Dans ma tête j'ai essayé de changer la formulation du problème : « lui m'attaque, car il ne sait pas » ; il n'a pas d'autre moyen d'expression. Je vais donc le mettre dans une telle situation de mouvement, de plaisir, que je vais lui enlever cette volonté d'agresser ; pas celle d'être attaquant, puissant, déterminé ou fort, juste celle de détruire.
Stage à Dublin, 2007
Guillaume Erard: Cette idée de construire est très importante dans ton enseignement. On doit tendre à la perfection, mais surtout ne pas se laisser diminuer par le fait que l'on fait des erreurs. Si on a peur de faire des erreurs, on n'ose plus rien faire et on s'excuse.
Philippe Gouttard : Quand on tord un poignet, la douleur n'est pas localisée uniquement sur le poignet, mais sur toute la chaîne musculaire jusqu'au point faible d'équilibre du moment. C'est pour cela qu'en Aikido il y a peu de blessures aiguës, mais beaucoup de blessures chroniques. Le corps s'y habitue et accepte la douleur jusqu'au jour où il te fait dire « non, je ne veux plus ». À ce moment-là, on se pose plein de questions : « mais pourquoi ? Pourtant, je n'ai jamais fait d'erreurs, je n'ai jamais été blessé, j'ai toujours fait attention... » C'est donc maintenant qu'il faut mettre de l'intelligence dans la pratique. Il ne faut pas changer les techniques, mais changer les esprits. Il faut éviter les maladresses. En Aikido, personne n'attaque pour faire mal, les blessures viennent souvent de maladresses. Il faut donc s'attacher à faire attention et surtout se libérer du vouloir bien faire pour tendre vers vouloir mieux faire. À vouloir toujours faire bien, on aboutit à la frustration. Je pense qu'il faut se laisser de la place pour progresser et se laisser faire des erreurs. Ce que je veux enlever c'est la perfection. On doit tendre à la perfection, mais surtout ne pas se laisser diminuer par le fait que l'on fait des erreurs. Si on a peur de faire des erreurs, on n'ose plus rien faire et on s'excuse. En ce moment, on parle tous les deux, on essaie de parler comme il faut, mais à un moment donné, on va faire des fautes de français. Si quelqu'un passe à ce moment-là, il dira « regarde cet abruti, il ne peut même pas parler correctement ». Le truc, c'est qu'on s'en fout : je préfère dire les choses comme je les ressens.
Après, on peut toujours corriger si ça a été mal dit ou mal interprété, plutôt que de faire attention tout le temps et ne se risquer à rien dire. Il faut être sérieux, ce n'est que de l'Aikido, on n'est pas en politique en train de réunifier un pays. C'est comme les photos et les vidéos, ça ne me dérange pas que quelqu'un me prenne en photo quand je suis un peu tordu. Les gens qui m'aiment bien diront « c'est juste dans cette situation-là », les autres trouveront toujours quelque chose de toute façon. Je préfère que ce soit naturel. Tu vois, quand un homme politique se trompe, je ne lui en veux pas, du moment qu'il rigole et dise « OK, je me suis trompé ».
Guillaume Erard : Effectivement, en stage, tu corriges assez peu la forme, mais tu passes beaucoup de temps sur le fond. certaines fois, on voit un autre pratiquant et on se dit : « ce mec est nul ! » Ce n'est pas qu'il est nul, mais il a des formes de corps, des attitudes, des mimiques qui nous agressent ; ça veut juste dire que l'on n'est pas encore assez fort pour accepter que l'autre soit différent de nous.
Philippe Gouttard : Oui, mais c'est aussi pour ça que je laisse la liberté à mes élèves : ils ont toujours raison, mais ils ont toujours raison de façon différente. On tend vers le bien en changeant de partenaire, en changeant de vision, de professeur, d'endroit. Il faut faire la même technique, mais essayer de comprendre pourquoi à tel endroit ça marche bien et à tel endroit pas. Tout le monde a la solution, mais la difficulté c'est de prendre suffisamment de temps pour réfléchir. Le professeur ne peut donner que sa solution parmi d'autres ; sa vérité pas la vérité. C'est comme en langue, on apprend et on parle bien à l'école, mais souvent on se retrouve perdu lorsque l'on visite un pays, à cause de l'accent, de la façon de parler ou juste de l'endroit que l'on visite. La difficulté vient du fait qu'il existe plusieurs façons de dire les choses et qu'elles sont toutes justes. Avec quelques mots, on peut dire les mêmes choses en France qu'au Japon. En revanche, ça devient très difficile quand on veut exprimer un sentiment. En Aikido, le shihonage est le même partout, mais certaines fois, on voit un autre pratiquant et on se dit : « ce mec est nul ! » Ce n'est pas qu'il est nul, mais il a des formes de corps, des attitudes, des mimiques qui nous agressent ; ça veut juste dire que l'on n'est pas encore assez fort pour accepter que l'autre soit différent de nous. Au lieu de dire que l'autre est nul, on devrait dire « je ne me suis pas assez entraîné pour le comprendre ». Donc je vais voir ailleurs et plus tard je retournerai le voir. C'est ce que j'ai essayé de faire au Japon. Avant, j'allais rarement voir les enseignants que je n'aimais pas. Maintenant j'y vais.

Philippe Gouttard et Guillaume Erard
Guillaume Erard : Pourquoi ?
Philippe Gouttard : Justement pour voir si je n'aime vraiment pas ou bien si je n'étais juste pas assez mûr pour les comprendre.
Guillaume Erard : Ce degré de liberté n'est-il pas déstabilisant pour un élève ? que dans sa vie, un élève ait besoin, pour son enrichissement, d'aller voir un autre enseignant, cela ne me choque pas puisque moi-même je l'ai fait. Après, on se retrouvera. C'est ça l'Aikido : c'est des chemins qui s'éloignent et se rapprochent.
Philippe Gouttard : La technique, je la donne et les élèves en font ce qu'ils veulent. Bien sûr j'ai les boules quand mes élèves me quittent, mais je serais encore plus triste s'ils restaient avec moi pour ne pas me faire de peine, car ils me considéreraient comme un petit vieux. Si un élève me dit : « Philippe, pendant un an je ne viendrai plus te voir parce que je veux voir tel professeur », je ne lui en voudrai pas du tout, au contraire. Ce qui me ferait de la peine, ce serait que l'on n'ait plus de relation humaine. Mais que dans sa vie, un élève ait besoin, pour son enrichissement, d'aller voir un autre enseignant, cela ne me choque pas puisque moi-même je l'ai fait. Après, on se retrouvera. C'est ça l'Aikido : c'est des chemins qui s'éloignent et se rapprochent. Quand on se croise, ce sont des moments très forts afin que, lorsque l'on est loin l'un de l'autre, on ne se sente pas coupable de s'être abandonnés. En tant que professeur, si tu donnes de l'intelligence, de la pratique, tu donnes aussi de la liberté. La liberté, ça n'a pas de prix. Au début, on ne peut pas être libre, on ne peut que croire son enseignant. On va dans un club par hasard et on nous dit qu'il n'y pas mieux ailleurs (sinon on irait ailleurs). Pourtant, avec la pratique, on se rend compte que ce qui est meilleur chez nous est en fait aussi bien qu'ailleurs, c'est la traduction des émotions qui est différente. C'est pour cela que pour moi les grades en Aikido n'ont pas une valeur technique, mais une valeur d'expérience et de formation.
Philippe Gouttard à Tokyo
Guillaume Erard : On juge effectivement beaucoup les autres sur un tapis d'Aikido...
Philippe Gouttard : Eh bien moi par exemple, je ne serai peut-être jamais 7° dan. Ça m'a travaillé pendant des années parce que je voulais être champion du monde. Maintenant je me dis « le 7° dan ça représente quoi ? » Un kotegaeshi meilleur que celui d'un 6° dan ? Aucune chance : il n'est pas meilleur, il est différent. Ce que l'on peut dire par contre, c'est que c'est le kotegaeshi d'un monsieur de 60 ans. Un 5° dan aura 35 - 40 ans, entre les deux il y a 20 ans de pratique : ce sont ces 20 ans qui font que ce n'est pas la même chose, pas le nombre de dan. C'est comme quand on compare le langage des enfants et celui des adultes, on utilise les mêmes mots, mais ils n'ont pas la même valeur humaine, sentimentale... Je sais juste qu'à Paris les gens peuvent s'entraîner six fois par semaine, trois fois par jour. Le pratiquant à Tipperary, s'il peut le faire deux fois par semaine, il est content. Les deux ont cependant la même valeur : il faut bien comprendre qu'au 1° dan à Paris ou à Tipperary, ce n'est pas le même niveau de vécu, mais c'est le même niveau d'investissement. C'est ça la beauté de l'Aikido, ce sont des gens qui sont très forts dans leur pratique et qui vont se rencontrer. On va donc voir si notre technique est suffisamment forte pour comprendre ce que l'autre va faire, et pas pour montrer que ce que l'on fait est juste. La technique doit nous permettre de nous rapprocher des autres, surtout pas de nous en éloigner et de dire que l'autre est nul. L'autre n'est pas nul, il fait ce qu'il croit bon pour lui ; des fois il n'a pas le choix. Par exemple, quand tu vas à Tokyo ou à Paris, il est normal de voir 30 ou 40 personnes dans les dojos.
Un enseignant à Galway, Cork ou Tipperary, quand il a 5 personnes sur le tapis, c'est aussi fort que 40 personnes à Paris. Est-ce que l'Aikido de Paris est meilleur ou moins bon que celui de Tipperary ? Je ne sais pas. Je sais juste qu'à Paris les gens peuvent s'entraîner six fois par semaine, trois fois par jour. Le pratiquant à Tipperary, s'il peut le faire deux fois par semaine, il est content. Les deux ont cependant la même valeur : il faut bien comprendre qu'au 1° dan à Paris ou à Tipperary, ce n'est pas le même niveau de vécu, mais c'est le même niveau d'investissement. Moi je demande aux professeurs et aux élèves qu'ils s'entraînent fort, sans penser qu'à Paris ou à Tipperary c'est nul ou c'est bien. Nous les élèves, on se sent toujours coupable, on se dit « je ne suis pas sur Paris et je n'ai jamais été à Tokyo, alors je ne peux pas comprendre ». Mais une fois qu'on va à Paris ou Tokyo finalement, on se sent souvent vide, sauf si la rencontre avec un professeur ou un élève nous a enrichi d'une connaissance que l'on ne pouvait pas avoir chez nous.

Philippe Gouttard
Guillaume Erard : Justement, est-il nécessaire d'aller au Japon pour progresser ?
Philippe Gouttard : Il faut y aller, mais ne pas trop y aller. Comme en Aikido, il faut pratiquer, mais pas trop. Trois fois par semaine, c'est suffisant, mais il faut le faire trois fois bien. Il est important de pouvoir prendre du recul pour digérer et réfléchir. Ce qui est vraiment important c'est cette connaissance corporelle extrêmement rigoureuse sur les axes physiologique et physique, qui permet de construire un mental, différent pour chacun d'entre nous, mais accessible à tout le monde. L'Aikido est accessible à tout le monde, mais tout le monde ne peut accéder à tout l'Aikido tel que le fondateur l'a créé.
Guillaume Erard : Donc on ne pratique pas le même Aikido que le fondateur ? Je n'aime pas beaucoup quand les gens disent qu'il faut pratiquer l'Aikido comme avant. Moi je dis « non, avant, c'était tarte ! » (rires). Avant il y avait moins de technique, moins de culture et d'intelligence, donc il fallait plus de discipline.
Philippe Gouttard : Chaque professeur, à chaque génération, a réfléchi à des choses de plus en plus pointues sur les plans physique, physiologique, mental. C'est pour cela que maintenant, je dirais que l'on travaille plus intelligemment qu'avant. Les conditions et la mentalité sont différentes, on fait de l'Aikido après le travail : on pourrait faire autre chose, du footing, etc. Il faut donc que l'Aikido évolue avec notre façon de vivre et nos besoins. Je n'aime pas beaucoup quand les gens disent qu'il faut pratiquer l'Aikido comme avant. Moi je dis « non, avant, c'était tarte ! » (rires). Avant il y avait moins de technique, moins de culture et d'intelligence, donc il fallait plus de discipline. Maintenant les gens qui viennent nous voir sont bien éduqués, ils sont auto-disciplinés. Il faut faire qu'au travers de la pratique, on souffre moins, on ne soit pas frustré, on ne soit pas jaloux. Si on est touché, il faut l'accepter, perdre un peu de notre amour propre ; un peu du 7° dan qui s'effrite.
On doit arriver à la maîtrise de l'échec et être, en somme, moins gamins. C'est par exemple pour cela que je fais travailler les gens dans une situation où ils n'ont plus le contrôle, en particulier au ken. Je pousse les élèves à faire des techniques au-delà de la réflexion pour que le corps « y aille ». Après, on dit peut-être « mince, je n'aurais pas dû », mais si on laisse le temps à l'esprit d'anticiper, on n'y va pas puisque l'on sait que l'on va mourir. Je suis sûr que les gens que l'on envoyait au combat dans le passé étaient des minables et des nuls : sinon, s'ils avaient eu de la technique, ils n'y seraient pas allés. Après s'ils revenaient, on leur donnait un niveau culturel et technique supérieur. Les vieux généraux qui connaissaient bien le système, eux ne partaient pas, sinon le niveau serait redescendu. La difficulté est d'aller au combat et d'en revenir. On devrait avoir cette même sensation quand on pratique.
Élève, on se dit souvent « j'ai été nul ». Alors c'est vrai qu'on a été nul, mais par rapport à quoi, à qui, a-t-on été nul ? Un professeur ? Un élève ? Hier ? Demain ? Ça n'a aucune importance si on pratique au maximum, seulement des fois le maximum de l'un c'est le minimum de l'autre. Il faut apprendre à relativiser. L'Aikido c'est un moyen pour se comprendre, il n'y a pas de solution, pas de vérité. Dans l'instant où il y a une saisie ou un contact, comment tous les deux va-t-on pouvoir maintenir ce contact et aller jusqu'au bout du système, du code, qui fait que le mouvement va bien ? Quand ils sont heureux, les gens sur le tapis disent : « je me suis amusé, éclaté, j'ai bien bougé ». Jamais quelqu'un ne m'a dit : « je me suis bien battu ». Ce n'est pas notre culture alors qu'on a passé tout notre temps à se battre. Pour moi l'Aikido c'est ça, c'est cette réflexion. C'est d'ailleurs pour ça que j'aime aller en Irlande : parce que l'Aikido est neuf là-bas, les gens en veulent. Ce que je regrette un peu en France et au Japon c'est que les professeurs montrent un peu moins d'engouement.
Guillaume Erard : Tu utilises un vocabulaire très expressif au niveau émotionnel. L'émotionnel est-il important dans ton approche ?
Philippe Gouttard : Énormément. Avant les passages de grade je vais souvent discuter avec les élèves pour savoir comment ils vivent les choses, comment ils se sentent. C'est important pour moi de comprendre la tristesse des gens quand ils ratent leur grade. Il ne faut jamais oublier l'investissement énorme de temps et d'énergie qu'ils ont fourni. Il faut enseigner, juger et sanctionner par un grade, mais aussi relever l'élève en cas de chute. C'est aussi la même chose avec les enseignants, lorsqu'on refuse de donner un grade, c'est aussi le professeur que l'on sanctionne. Il faut que les élèves fassent confiance au professeur, mais aussi que le professeur soit tolérant vis-à-vis des réactions des élèves. Ça va toujours dans les deux sens, l'enseignant doit accepter que son élève aille voir ailleurs, mais l'élève doit se souvenir que s'il a les outils pour comprendre telle ou telle autre personne c'est grâce à tout le travail de son premier professeur. Cela dit, même si l'affectif est important, on apprend aussi à relativiser.
Quand Christian Tissier m'engueule, je relativise. Mais de toute façon, je préfère qu'il m'engueule plutôt que de passer à côté de moi sans montrer aucun intérêt. Je préfère qu'il me dise « mais qu'est ce que tu fous ?! ». Je faisais d'ailleurs ça au Japon, quand Maître Yamaguchi ou un autre ne venait pas me voir : ça m'énervait alors je travaillais volontairement mal, ou bien je bousculais un peu le partenaire pour qu'il vienne et qu'il m'engueule. Il faut que les élèves fassent confiance au professeur, mais aussi que le professeur soit tolérant vis-à-vis des réactions des élèves. Ça va toujours dans les deux sens, l'enseignant doit accepter que son élève aille voir ailleurs, mais l'élève doit se souvenir que s'il a les outils pour comprendre telle ou telle autre personne c'est grâce à tout le travail de son premier professeur.
Guillaume Erard : Avec tous les gens qui commencent les arts martiaux, le plus souvent pour apprendre à se défendre, tu ne penses pas qu'il y a un problème de paranoïa dans notre société ?
Philippe Gouttard : Si, mais c'est parce que les gens ne se posent pas les bonnes questions. C'est aussi la faute des professeurs qui n'enseignent que de la technique. Quand on enseigne la technique on enseigne la différence, il y a celui qui y arrive et celui qui n'y arrive pas. Quand on mange, on fait tous le même geste, après, on réagit à la nourriture différemment : « c'est bon, ce n'est pas bon », mais on ne t'a jamais « enseigné » à manger. Un enfant qui mange, on ne lui a pas appris, il a juste regardé ses parents. Il ne faut pas enseigner la technique, il faut la faire vivre, la transmettre corporellement. Si on ne parlait que de combat, je ne vois pas pourquoi je t'enseignerais shihonage si c'est pour me casser la gueule juste après. Mon but quand je rencontre le gros méchant dans la rue, c'est de lui faire ma plus belle technique, celle pour laquelle je me suis tellement entraîné toute ma vie, afin de l'entendre me dire « monsieur, j'aimerais passer entre vos mains une deuxième fois ». Ce qui est intéressant c'est de prendre des gens avec des appréhensions et des angoisses et, avec la pratique, leur donner confiance. C'est ça que je veux faire en Aikido, simplement donner des étapes et permettre aux gens de s'ouvrir et de pouvoir se sentir à l'aise.
Guillaume Erard : Et que penses-tu des gens qui pratiquent depuis 30 ans avec pour seul objectif la défense ?
Philippe Gouttard : Ce sont des gens qui ont peur tout le temps, car ils n'ont pas eu de guide. on est sur le tapis et on y va ! C'est une dictature : pas de sentiments, ni religion, ni politique. Le sexe est inexistant : une fille sur le tapis n'est qu'un partenaire plus petit et je veux la faire souffrir autant qu'un homme pour qu'elle comprenne qu'il n'y a pas de différence et que l'on mérite tous de travailler pareil.
Guillaume Erard : L'aspect social de la pratique est-il important pour toi ?
Philippe Gouttard : Il est très important hors du tapis. On peut parler, pleurer, faire des câlins toute la nuit, mais le lendemain matin à neuf heures, crack, on est sur le tapis et on y va ! C'est une dictature : pas de sentiments, ni religion, ni politique. Le sexe est inexistant : une fille sur le tapis n'est qu'un partenaire plus petit et je veux la faire souffrir autant qu'un homme pour qu'elle comprenne qu'il n'y a pas de différence et que l'on mérite tous de travailler pareil. Par contre, pour moi, on fait plus d'Aikido que l'on ne le croit le samedi soir, alors que l'on partage un bon repas et une bonne boisson. Eh oui, après ça, le dimanche matin, le gros méchant de la veille, il n'est plus aussi méchant tout compte fait, il est comme nous ; c'est juste qu'on ne s'est pas compris.
Guillaume Erard : Tu travailles toujours à la limite du physique et de la douleur...
Philippe Gouttard : En Aikido il faut atteindre des limites au-delà desquelles il ne faut pas aller. Quand on pratique, si je vais au-delà des limites du partenaire, je l'ai violé, mais si je ne les atteins pas, je l'ai trompé. En Aikido, on va toujours en avant, quand on ne peut plus aller en avant, on change d'avant.
Guillaume Erard : Un dernier mot pour finir ?
Philippe Gouttard : Donnez de la force à l'autre. Si vous êtes forts, c'est pour aider l'autre, pas pour l'écraser.